|
| |
 Mentalités et tradition : un frein au développement sanitaire
Mentalités et tradition : un frein au développement sanitaire
 |
Durant
notre séjour à Niéna, une question revenait souvent dans nos
discussions avec les habitants du village : le poids de la
tradition, et en quoi celui-ci peut constituer un frein au
développement, notamment dans le domaine de la santé. Les femmes,
principales victimes de ce problème, ne s’expriment pas sur le sujet,
par gêne et surtout parce qu’elles n’ont pas l’habitude de donner
leur avis. Nous avons donc parlé avec des hommes mais également avec
les trois matrones du centre de santé de Niéna. |
|
De ces discussions découlèrent trois sujets
principaux : l’excision, dont la pratique n’est pas sans
risques, la contraception, encore très peu utilisée, et le sida,
fléau présent à Niéna comme dans le reste de l’Afrique.
I) L’excision
L e problème de l’excision a donné lieu
à de nombreux débats. L’argument qu’avancent les hommes Niénakas
pour justifier sa pratique est qu’une femme non excisée attendrait
plus de son mari qu’il ne pourrait en donner, étant la plupart du
temps polygame et devant donc remplir ses devoirs conjugaux autant avec
chacune de ses femmes ( dont le nombre, au Mali, peut aller jusqu’à
quatre). Insatisfaite, celle-ci risquerait d’aller " voir
ailleurs " et tromper son mari. Un argument s’avérant…très
discutable, bien entendu.
La pratique de l’excision trouve son origine dans
un mélange de superstitions, de tradition ancestrale et de religion,
celle-ci étant censée éloigner le mauvais sort, la maladie, la folie,
la stérilité et même favoriser la naissance des fils si précieux.
Premières concernées, les femmes ont du mal à s’exprimer sur la
question : l’excision est une tradition et une femme non excisée
serait rejetée par la communauté et jugée impure. Pourtant, les
matrones de Niéna admettent que l’excision est une pratique
dangereuse qui donne lieu à beaucoup de saignements. Mais l’avis
médical est ici impuissant face à la tradition.
L’opération doit être pratiquée par un forgeron.
Il y a encore une vingtaine d’années, l’excision se pratiquait à l’âge
de 18/20 ans, durant le mois précédant le mariage. Aujourd’hui, elle
se fait au courant du mois qui suit la naissance.
On estime à 130 millions le nombre de filles et de
femmes qui ont subi cette pratique, et qu’au moins deux millions de
filles par an risquent de subir cette procédure.
II) La
contraception
A utre problème lié aux contraintes
sociales et à la tradition, le refus de la contraception est largement
majoritaire à Niéna. Son utilisation permettrait de réduire le nombre
de grossesses rapprochées, dangereuses pour les femmes, ainsi que le
nombre de grossesses non désirées. Au Mali, la moyenne d’enfants par
femme est de sept.
Les matrones nous disent que beaucoup de maris
interdisent la contraception à leurs femmes. Son utilisation est jugée
contraire à la religion et reste incompatible avec les
mentalités : le principal but de la personne humaine étant de
procréer, mettre un frein à la procréation est jugé contre nature et
totalement immoral. Petit à petit, les mentalités commencent à
changer : certaines femmes de Niéna prennent la pilule
contraceptive, et l’utilisation de préservatifs se fait de moins en
moins rare (ce sont principalement des jeunes qui les utilisent). Un
autre problème est que, souvent, les femmes ne connaissent pas la
contraception.
|
Pour remédier à ce problème, les
matrones du centre de santé de Niéna organisent deux fois par
semaine des " causeries ", permettant de
sensibiliser les femmes, et les rares hommes qui acceptent de
venir, aux différents moyens de contraception :
préservatifs et pilules (une plaquette coûte 100 francs CFA c’est
à dire 1FF). Lors de ces causeries, se font également des
discussions sur l’importance des consultations prénatales, le
danger des grossesses rapprochées… |

|
II) Le sida
|
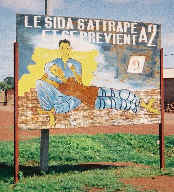
|
Le sida existe à Niéna, d’autant plus que la route qui va de Bamako à Abidjan traverse le village, qui se retrouve ainsi un lieu de passage pour toutes sortes de gens.
Le nombre de séropositifs est difficile à définir, car très peu de personnes font le test de dépistage et toute maladie grave est prise pour le paludisme. De plus, les Maliens sont profondément animistes et pensent par conséquent que la cause d’une maladie grave est un mauvais sort, une punition de Dieu, croyant peu à une raison scientifique de la maladie.
|
|
La question du sida reste en tous cas un
sujet tabou. Seul les jeunes abordent le sujet entre eux. La
sensibilisation à cette maladie est active et de nombreuses ONG
parcourent la région et distribuent des prospectus et des
préservatifs, tout en organisant des discussions autour du
sujet. Sur Radio Teriya, la radio locale créée par l’association
Teriya Amitié Mali, des programmes de sensibilisation avec des
interviews d’infirmiers du centre de santé sont
régulièrement diffusés.
Mais pour les générations plus âgées, le Sida reste une
maladie inventée par les Américains pour s’enrichir…
|

|
|
![]()
![]()
