![]()
![]()
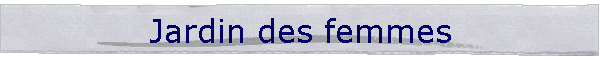
|
|
|
|
Un encadrement et un soutien technique : Nous avons pu rencontrer Méguéto Koné, agronome de formation, conseiller pour les jardins des femmes, assisté de Fatoumata Dao (vétérinaire), chargée de l’organisation paysanne des femmes. Elle a suivi une spécialisation dans le maraîchage. Tous deux sont les interlocuteurs privilégiés de ces femmes. Lorsqu’ils sont absents, l’essor des jardins ralentit un peu. Méguéto a visité tous les jardins. Leur suivi est répertorié dans un cahier de visite. Une rencontre ultérieure visera à vérifier si les conseils de techniques de semences, de préparation du sol… sont bien suivis. Bien entendu ils le sont en grande majorité ! Méguéto aimerait mettre en place un système d’échange entre les différents groupes de femmes : visite des autres jardins, échanges d’astuces… Un planning officiel pourrait ainsi être établi. Méguéto estime qu’une subvention pour son carburant lui permettrait de plus nombreuses visites. Il se rend tous les quinze jours à Karangasso. L’A ACAER (Antenne Appui Conseil Aménagement Equipe Rurale) de Niéna est en mesure d’effectuer des formations sur le maraîchage, toutefois une documentation plus fournie leur serait utile.
Les sites : Tous déplorent des problèmes d’eau car rares sont les puits à proximité. Le jardin de Sokourani n’a pu être réalisé cette année car les femmes n’avaient pas de parcelle à leur disposition. A la place, elles ont fait des savons. En revanche Babala va avoir son propre site, donné par le chef du village, mais relativement loin d’un point d’eau et pas encore clôturé ; Karangasso et Brigan ont déjà leur propre terrain. Les autres exploitent des lots privés, mais restent prioritaires à l’acquisition des terres exploitées en accord avec la mairie. Des sites plus appropriés, avec forage de puits à grands diamètres permettraient un meilleur rendement. La gestion : La très grande motivation des femmes a permis un engagement de fonds pour les pépinières avant même l’exploitation des semences. Les femmes ont leur propre caisse et gèrent elles-mêmes leur budget. L’adhésion est de 750 FCFA avec une possibilité d’échelonnement. La production est tout d’abord pour leur propre consommation puis l’excèdent est vendu. Chaque groupe a établi ses propres critères d’adhésion et est structuré : une présidente, une trésorière, des responsables des ventes… On y retrouve différents niveaux sociaux, différents âges… L’organisation du travail : L’organisation est bien établie et respectée ; en voici deux exemples : - A Karangasso, les femmes sont réparties en quatre groupes. Chaque jour un groupe différent travaille, un roulement est ainsi établi. Cette association leur permet de se réunir afin de discuter sur le développement du village tout en faisant un travail utile et plaisant. Elles regrettent de ne pas pouvoir visiter les jardins de Niéna, c’est pourquoi le projet de visite de tous les jardins par Méguéto est très apprécié. Un renouvellement du matériel (trois arrosoirs, des pioches, du grillage) est souhaité. Cette année, le démarrage en Février a été un peu tardif. - A Medina Koura il y a vingt-quatre femmes qui y travaillent. Certaines règles doivent être respectées ; par exemple d’être toujours présent lorsque c’est son jour de travail. Au bout de trois absences la fautive est renvoyée du groupe. La parcelle est divisée en planches ; une ou deux femmes par planches. Chacune entretient et arrose sa partie. Ainsi une petite concurrence interne s’installe et motive encore davantage les femmes. Deux d’entre elles sont uniquement chargées de la vente, tout commerce doit passer par elles. Le matériel :
Kabougoula n’est pas du tout équipé en petit matériel : arrosoir, grillage… Tous les groupes aimeraient voir leur matériel renouvelé. Ils possèdent actuellement des arrosoirs, des pioches, des brouettes lourdes, des râteaux… Des gants seraient appréciés. Toutefois, ce matériel est bien utilisé. Les parcelles sont grillagées (en partie seulement pour certaines comme à Niassala). Il serait intéressant que les femmes intègrent dans leur projet l’achat de matériel, de grillage… afin d’obtenir une totale indépendance. Semences et cultures : Cette année, les sites de Babala, Bringan, Medina Koura, Mena, Karangasso, Herema Kono, Kabougoula ont reçu des semences. Certains villages produisent des semences locales, lesquelles sont privilégiées à celles fournies par Teriya de par leur coût. Lorsque les graines arrivent, les femmes intéressées sont invitées à venir les chercher à l’A ACAER de Niéna. Les semences de l’année passée étaient de bonne qualité ; une carence en gombo s’est révélée. En revanche, les oignons restent, ceci est dû à une superstition selon laquelle les oignons assèchent la terre ! A Babala, les femmes ont commencé plus tôt que d’habitude, à savoir en Octobre au lieu de Décembre. Cette avance a permis de profiter d’avantage de l’humidité après la saison des pluies. Il serait donc profitable que les semences arrivent en Septembre afin d’effectuer un bon démarrage de la saison. En effet l’installation du gombo en pépinière dès Octobre est une réussite ! Les plantations se font principalement en ligne et en planches. Les pépinières sont généralement intégrées directement dans les jardins. L’arrosage est effectué chaque jour. Les essais sur les pommes de terre n’ont pu être réalisé car personne n’a investi de fonds. Aubergines, gombo, salades, choux, tomates, piments, haricots… poussent très bien, mais les carottes ont peu germé. Il serait intéressant de trouver des variétés actives sur au moins trois mois. De nombreuses parcelles de riziculture demeurent inexploitées ; il y a peu de variété de riz. Une augmentation de la production permettrait d’accéder aux techniques de séchage. Le compostage reste une technique insuffisamment exploitée. Les fleurs ne sont bien entendu pas un sujet de préoccupation !
Parasites et traitement : La production des jardins est altérée par la présence de nombreux parasites : coléoptères, criquets et vers en particulier. Les traitements naturels sont favorisés dans la mesure du possible ; par exemple les feuilles de " nime " fermentées constituent un excellent répulsif. En dernier recours les traitements chimiques, tel que le D5, sont utilisés. L’apport massif de fumure organique attire les parasites. D’autre part, les clôtures grillagées et le séko permettent de protéger les plantations des éventuels herbivores de passage (un hectare clôturé cette année à Sokourani). Conclusion : Les jardins des femmes semblent être une remarquable réussite. La motivation et l’intérêt porté l’illustrent bien ! Les femmes sont très nombreuses dans chaque groupe (minimum vingt par groupe) et des demandes d’adhésion continuent toujours. De nombreux groupes aimeraient voir la taille de leur parcelle s’agrandir nettement ! Ce projet permet aux femmes de se réunir entre elles et de s’émanciper.
|
|