![]()
![]()
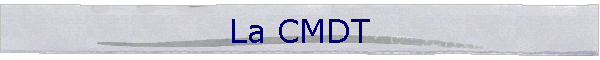
|
|
|
|
LES MISSIONS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA CMDT
La Compagnie Malienne pour le Développement du Textile (CMDT), est une entreprise d’Etat créée en 1974 pour gérer la filière coton au Mali. Elle est chargée d’organiser la production et la commercialisation du coton sur l’étendue du territoire malien. La CMDT est financée à 60% par l’Etat Malien et à 40% par la Compagnie Française du Développement Textile (elle est donc privatisé en partie). Dans tout le Mali, la CMDT a construit les infrastructures nécessaires au développement d’une filière coton concurrentielle sur les marchés internationaux. Dans ce cadre, elle s’est largement investie auprès des populations des régions cotonnières et son action a largement contribué à leur essor économique. Perçus comme des nantis, touchant des salaires plus élevés que ceux des cadres de la fonction publique même, les agents de la CMDT devaient faire face à l’hostilité des villageois pour mener à bien leurs missions de développement. Mais après quelques échauffourées entre villageois et agents CMDT, l’influence bénéfique de la Compagnie Malienne a commencé à être reconnue. Malheureusement, suite à la baisse des cours du coton sur les marchés mondiaux, les résultats de la CMDT se sont significativement dégradés. Devant les déficits annuels de la société, la Banque Mondiale et le FMI ont sommé l’Etat Malien d’assainir les comptes de la CMDT dans l’optique de sa privatisation à l’horizon 2008. . LES MISSIONS D’AIDE AU DEVELOPPEMENT DE LA CMDTA Niéna, comme dans tous les villages Maliens de l’Est et du Sud, les travaux de développement réalisés par la CMDT sont visibles. A. Le tracé et l’entretien des pistesLa vocation première de la société est de promouvoir la culture du coton et, pour valoriser les plantations, la CMDT avait adopté deux méthodes. La première consistait à fournir des engrais aux planteurs, qui, grâce aux conseils d’experts, ont rapidement développé leurs exploitations. Mais la CMDT n’a jamais perdu de vue sa mission de développement économique et social. Alors qu’elle aurait pu imposer une exploitation intensive des terres arables, la CMDT obligeait les producteurs à répartir leurs cultures de la manière suivante : 1/3 pour la production de coton, 2/3 pour les cultures nourricières. Pour l’exploitation de ces dernières, la CMDT mettait à disposition des agriculteurs des engrais à moindre coût… Par souci de productivité la CMDT a du développer les infrastructures nécessaires à l’acheminement de véhicules dans les champs de coton. Elle a ainsi créé un réseau de pistes permettant l’accès de camions de 10 T aux plantations. Concrètement autours de Niéna, se ne sont pas moins de 8 grandes pistes et une douzaine de pistes secondaires qui ont été ouvertes. Dans le cercle de Sikasso, toutes les pistes non goudronnées ont été créées par les engins de la CMDT : elles relient les champs de cotons aux routes nationales, les villages aux communes, les hommes aux marchés et aux centres administratifs de leur région. B. LES FORAGESLa CMDT a aussi réalisé de nombreux forages de puits pour apporter l’eau, toujours insuffisante, aux villages dans lesquels avaient lieu ses activités. Le forage d’un puit étant une opération très coûteuse, tous les villages n’en ont pas bénéficié. La société a reçu des techniciens, formé en France, qui ont sillonné le pays pour y construire des puits. Finalement, de tous les travaux de développement entrepris par la CMDT, le forage a été le plus apprécié des communautés villageoises. Dans de nombreux villages maliens, tous les puits ont été construits et entretenus par la CMDT. Niéna a bénéficié en plus de l’aide de Teriya et du Conseil Général. II. LA FUTURE PRIVATISATION ET SES CONSÉQUENCESA. L’alphabétisationDepuis les États Généraux de 2000 et l’annonce de la privatisation, la CMDT a décidé d’assurer l’avenir des producteurs de coton en les préparant aux changements à venir. L’alphabétisation est la clé de voûte de la politique de soutien de la compagnie auprès des petits planteurs. La stratégie de la CMDT était d’instruire les producteurs de coton pour qu’ils puissent s’organiser en coopérative et renforcer leur pouvoir de négociation face à leurs futurs clients (la CMDT privatisée ainsi que ses concurrents nationaux ou internationaux). La CMDT a donc décidé d’alphabétiser le secrétaire général de chaque Association Villageoise (une par quartier) pour lui enseigner ensuite le métier de formateur en alphabétisation. Cette initiation, d’une durée de 45 jours, était intégralement financée par la compagnie malienne. Le rôle des secrétaires des associations villageoises était de former à leur tour de nouveaux animateurs, et la CMDT à mis en place un suivi régulier du processus d’alphabétisation pour en assurer la pérennité. B. L’abandon des missions socialesDans le cadre de la privatisation, la Banque mondiale et le FMI ont exigé de la CMDT qu’elle se recentre sur son activité cotonnière. En effet, les difficultés financières, rencontrées suite à la baisse des cours sur les marchés internationaux, obligent la CMDT a assainir ses comptes et redéfinir ses orientations. Lors des États Généraux de la société en 2000, les actions d’aide au développement ont été officiellement abandonnées. Ainsi, le forage des puits, la distribution des engrais, hors engrais coton, ou encore l’alphabétisation des villages, ont commencé à disparaître. Seules subsistent les activités essentielles au commerce de coton. Ainsi, les pistes reliant les champs de coton aux communes continuerons d’être entretenues grâce aux équipements de la CMDT. Conclusion : La CMDT cessera toute activité de développement en 2008, mais elle a su mettre à profit les huit dernières années avant la privatisation pour préparer les producteurs de coton à cette transition. La mission d’alphabétisation de la compagnie malienne était une opération ponctuelle à cet effet et il faut désormais compter sans la CMDT pour la formation d’animateurs. Néanmoins les secrétaires généraux des Associations villageoises représentent une population instruite apte à participer à l’alphabétisation des femmes et des enfants. Ce sont des partenaires à ne pas sous estimer.
|
|