![]()
![]()
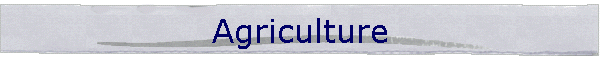
|
|
|
|
1-
Les jardins des femmes
Nous avons visité un jardin dans le quartier de Sokorami. Son
fonctionnement est le même que pour le reste des jardins de la ville: les
femmes du quartier s'organisent en équipe et travaillent en alternant les jours
de la semaine. Les week- end elles vendent leurs produits sur les marchés. Les
gains sont ensuite reversés dans une caisse communautaire qui finance entre
autre l'entretien et l'achat de graines et d'outils pour la plantation. Les récoltes
ne sont pas les mêmes tout au long de l'année. Durant l'hivernage les légumes
et céréales cultivés sont essentiellement le maïs, l'aubergine et le gombo.
Nous devions participer au desherbage du jardin de Worokiatu avec les
femmes, mais malheureusement cela n'a jamais été possible à cause des intempéries.
De même, les différents rendez- vous pris avec Méquéto Koné n'ont jamais
abouti. La cause de ses absences répétées nous échappe. Nous avons néanmoins
pu constater que les jardins sont clôturés et bien entretenus. Quelques puits
ont déjà été creusés, d'autres doivent encore être réalisés. 2-
La Coopérative Malienne Du Textile (C.M.D.T)
La Coopérative Malienne du Textile est une compagnie mixte, à 40% privée
(avec comme actionnaire la firme française Agriss) et à 60% publique. Elle est
présente uniquement sur la zone Sud du Mali, dans les quatre régions où il
pleut plus que 700 millimètres cube d'eau par an (Sikasso, Kourikoro, Kayes, et
Ségou). Pour un meilleur fonctionnement, la C.M.D.T. a remodelé ce découpage
administratif en six régions: Sikasso, Bougouni, Kutiala, Fana, San et Kita. La
zone de Sikasso est elle-même partagée en cinq secteurs, et au sein de chaque
secteur il existe un découpage en Zone de Production Agricole (Z.P.A). Cette
dernière cellule comprend plusieurs coopératives avec un statut juridique à
part entière, anciennement appelées Association Villageoise (AV). Elles se
constituent en groupes de personnes qui ont un projet commun et s'organisent
autour d'un bureau travaillant sur
les techniques agricoles villageoises ainsi que sur les modalités et la qualité
des marchandises à commercialiser.
A Niéna il y a cinq coopératives, gérées par El Hadji Oumar Tandina,
chef du secteur C.M.D.T. Niéna depuis huit mois. Les membres doivent tous
cultiver le coton, que ce soit dans leur terrain propre ou dans un champs
appartenant à la coopérative. Après les récoltes, des camions de la C.M.D.T.
pèsent et paient le coton au kilo, et il revient aux bureaux de redistribuer la
somme gagnée à chaque agriculteur selon sa production. Comme la culture du
coton se fait de fin Mai à Octobre, les membres s'organisent en maraîchage
autour d'un système de rotation: une période de l'année est consacrée au maïs,
une autre au sorgho, etc. Au début, les paysans ont été formés, puis encadrés
par la C.M.D.T. afin d'assurer une bonne productivité et un bon rendement, mais
aujourd'hui cela se fait d'une manière autonome. De même, la compagnie finançait
le matériel et l'équipement nécessaire, mais désormais les artisans locaux
peuvent répondre à la demande. Ils ont ainsi créé un système agricole se
suffisant à lui-même. Nous en avons profité pour demander si la compagnie
envisageait une prise en charge sociale, afin d'empêcher certains abus comme le
travail des enfants en bas âge. Monsieur Tandina nous a expliqué qu'ils
interviennent lorsque les enfants sont vraiment trop jeunes, mais que leur
champs d'action est relativement limité. Il pense néanmoins que cela serait un
objectif réalisable à l'avenir, puisque la C.M.D.T. a déjà contribué à une
amélioration sociale, en aidant à l'alphabétisation des agriculteurs.
La Coopérative Malienne du Textile exporte 99% de sa production sur le
marché mondial, surtout en Chine et aux Etats- Unis. Le pourcent restant est
mis en vente au Mali. Pour pouvoir exporter le coton, celui- ci doit auparavant
être travaillé dans une des quatre usines d'égrainage du pays. Les graines
sont utilisées pour fabriquer de l'huile de consommation, et les déchets
vendus comme nourriture pour le bétail. Malheureusement la C.M.D.T. connaît
une grave crise financière depuis la chute du prix du coton, ce qui entraîne
de grandes répercussions sur son fonctionnement. Elle n'a plus les moyens nécessaires
pour superviser le matériel, et ses infrastructures deviennent obsolètes.
3-
La coopérative des mangues
Depuis quelques années, la production cotonnière qui apportait 80% des
revenus aux producteurs s'est nettement détériorée avec la chute du prix du
coton. Face à ce problème économique grave un certain nombre de planteurs et
de maraîchers du Ganadougou (région de Sikasso et à cheval sur les cercles de
Sikasso et de Kolondiéba) se sont regroupés en une association et coopérative
en 1998 , et ont finalement obtenu leur récépissé le 9 octobre 2003. Elle
compte aujourd'hui 228 membres, qui travaillent sur 14 communes. Ils
communiquent grâce à la radio et se réunissent en assemblée générale une
fois par trimestre autour de leur président Monsieur Daouda Sangare. Pour
devenir membre, il faut être propriétaire d'une plantation de mangues, de noix
d'acajou, d'agrumes ou d'eucalyptus d'au moins un demi-hectare. Ils payent l'adhésion
de 2500 francs CFA par an et versent 5000 francs CFA pour obtenir la carte de
membre.
Ils sont tous persuadés qu'en se regroupant et en étant solidaires, ils
amélioreront leur situation socio-économique individuelle et contribueront aux
efforts de développement agricole du pays. Les plantations représentent en
effet un moyen de lutter efficacement contre la désertification sévissant au
Mali. Ils ont d'ailleurs déjà négocié et bénéficié d'un prêt de 5
millions de francs CFA auprès de la Banque Malienne de Solidarité. Cette année
ils sont dans l'expectative de recevoir une somme de 15 900 000 francs CFA de la
B.M.S.
Leurs activités tournent pour le moment autour de deux objectifs
principaux. Dans un premier temps ils renforcent leur capacité de production en
se réunissant et en s'échangeant leurs connaissances sur les techniques
agricoles. Pour prendre l'exemple du greffage, il existe aujourd'hui un membre
capable d'en réaliser dans chaque village. Cette personne organise des séances
théoriques et pratiques sur ce thème afin de communiquer son savoir aux
novices dans la matière.
Dans un deuxième temps, ils espèrent tirer profit de ressources
naturelles jusqu'ici encore inexploitées. Un exemple en serait la quantité
abondante de mangues délaissées par les villageois qui ne voient pas d'intérêt
particulier à ce fruit. La CPMG qui déplore ce gâchis compte bien créer un
commerce, dans le meilleur des cas international, de ces fruits ou des produits
dérivés ( fruits secs, jus, confiture, etc...). Ils ont dans cette optique reçu
une aide de 150 000 francs CFA de la part de Teriya, grâce auxquels plusieurs
membres de l'association tel que Moussa Diallo ont pu se rendre auprès de
différentes entreprises afin de leur soumettre leur projet et leur
proposer un partenariat. Le
Mali ne possédant pas beaucoup d'infrastructures, ils ont voyagé au
Burkina-Faso en quête de nouveau partenaires. Malheureusement à ce jour aucune
réponse favorable ne leur a été communiquée. Ils ne perdent pourtant pas
espoir car Magalie, une correspondante de Teriya, leur a récemment envoyé un
paquet de mangues séchées du Burkina en partenariat avec une association du
commerce équitable: Solidar Monde Fam Import. Cela leur a donné de nouvelles
pistes de recherche et ils comptent sur Teriya pour les aider à démarcher
depuis la France également. En effet le Mali a un atout majeur: sa production
de mangues étant massive, les prix sont très compétitifs. Pourtant ils
assistent impuissants à un trafic illégal. Des ivoiriens achètent des
mangues, les ramènent pour les étiqueter comme provenant de Côte d'Ivoire.
Cela les révolte énormement.
Ce projet et les hommes qui le soutiennent nous ont particulièrement
touchés. Il nous paraît bien structuré et plein de bonnes idées à
approfondir. Il nous semble également que cette coopérative pourrait être un
moteur essentiel au développement économique, social et écologique de la région.
De plus l'idée du commerce équitable est séduisante puisqu'elle bénéficie
aussi bien aux clients qui achètent de la nourriture saine qu'aux producteurs
qui s'insèrent dans le commerce mondial et participe
au progrès de leur pays. 4-
L'association pour la préservation de la nature.
Nous avons rencontré son responsable, Monsieur Abel Barafo Kouloubali.
Cette association étatique chargée depuis 6 ans de la protection de la nature
dans la région du Badadougou comprend 11 communes telles que Niéna, Fékolo,
Ganadougou, Blendio... Elle a été mise en place par le gouvernement car il
n'avait pas assez de moyens pour sensibiliser la population. Afin de faire
passer le message de manière plus percutante, il a installé des permanences au
sein même des villages pour leur assurer une meilleure information. Celle de Niéna
existe depuis 4 ans. Leur objectif principal est la protection de
l'environnement par une utilisation rationnelle des ressources: les paysans
doivent comprendre que la terre doit reposer plusieurs années pour se régénérer
et être plus riche par exemple. Certaines régions du Mali ont déjà connu des
exodes à cause de ce problème, et celle de Ségou semble être complètement détruite.
Le rôle principal de l'association reste donc d'informer régulièrement
la population. Elle utilise pour cela la radio Teriya, où elle mène une émission
de sensibilisation les samedis de 10h à 11h30. Elle organise aussi des réunions,
durant lesquelles les villageois débattent sur leurs problèmes, les analysent
et dégagent des solutions. De cette façon se crée un partenariat entre les
planteurs du Ganadougou et l'association pour la préservation de la nature.
Leurs actions concrètes pour remédier aux problèmes écologiques sont le
reboisement et la lutte contre les feux de brousse. Ils laissent à la commune
la gestion de l'assainissement de la ville et des déchets, car ils ne
s'occupent que de la préservation des ressources naturelles (l'eau et le sol)
et des espèces animales en voie de disparition (animaux aquatiques, singes,
phacochères, éléphants). Monsieur Kouloubali a ainsi fait remarquer qu'il
existe un étroit lien entre la disparition de certains animaux et la dégradation
des végétaux. Des éléphants, installés dans la région de Niena, se sont
vus chassés de leur territoire par des cultivateurs qui voyaient leur
production diminuer. Il veut donc rétablir une biodiversité: si l'homme agit
en faveur de l'écologie, respecte mieux la nature, les animaux reviendront.
|
|