![]()
![]()
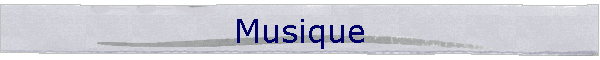
|
|
|
|
Musique et danseLa
musique et la danse traditionnelle.
Au Mali il y a 11 ethnies. Chacune possède sa musique et sa danse. Voici
les principales : La
musique traditionnelle joue un rôle social par exemple lors des enterrements où
les musiciens utilisent deux guitares appelées Bomlon et chantent. On fait l’éloge
du défunt. Ce n’est pas religieux, c’est animiste. Ces même instruments
sont utilisés pour faire l’éloge d’un cultivateur. Au début et à la fin
de l’hivernage, ils faisaient une grande fête, avec des balafonistes et des
joueurs de tam-tam. Les musiciens accompagnaient les travailleurs dans les
champs afin de les encourager dans leur travail. Il y a aussi différents types de
musiques traditionnelles pour les femmes, les guerriers ou les chasseurs. Les
chasseurs, nommés Dozo jouent une guitare appelée Dozo n’goni. Les chasseurs
sont une confrérie animiste. Lors de notre séjour à Niéna, un soir, on
entendit une musique venant de loin. Nous avons demandé si nous pouvions
participer à la soirée organisée. Nous sommes arrivé chez un de nos voisins.
On nous dit qu’il est un ancien chasseur et que trois Dozos venus de la région
de Bamako sont descendus à Niéna pour lui rendre visite. A fin de faire son éloge,
ils jouaient de la Dozo n’goni en chantant et en dansant. L’un d’eux était
habillé en tenue traditionnel, c’est à dire recouvert d’une peau de bête.
Les deux autres le suivait dans sa musique et dans sa danse.
Danse traditionnelle.
La danse traditionnelle se perd. Les jeunes accordent de moins en moins
d’importance aux traditions. On danse pour les fêtes sociales, comme les
mariages, les baptêmes, le ramadan etc…. Les jeunes enfants apprennent en
imitant les adultes danser. En général, les femmes dansent plus que les
hommes, ces derniers se retenant pour des raisons de bienséance , puisque cela
ne fait pas sérieux. Nous
avons découvert différents types de danses : Souvent, les musiciens choisissent la musique en fonction des danseurs. Musique traditionnelle. Tout le monde connaît les chansons
traditionnelles. Cette musique plait encore beaucoup aux maliens, et certains
commencent à faire des enregistrements. L’apprentissage de la musique se
transmet de père en fils. Ce sont les hommes qui jouent d’un instrument de
musique, les femmes, elles, dansent, chantent et jouent de la Boli. La musique traditionnelle est toujours
porteuse d’un message moralisateur. Les paroles semblent pour certaines
chansons évoluer avec l’actualité. Par exemple, N’Kafara Bamako Takala,
qui signifie « il faut que les filles arrêtent de partir travailler à
Bamako car elles reviennent enceintes. » Pour les thèmes traditionnels, beaucoup
de chansons portent sur l’accueil et le respect des autres comme « Saramala
Malo Mayé ». Le thème de l’entraide revient souvent comme dans la
chanson « Makoya Guessi Kabou ». Tous les aspects de la vie sont évoqués
dans les chansons comme la mort, l’amitié, la prétention, l’injustice…. La musique à Niéna.
Il n’y a pas de professeur de musique à Niéna. Il existe une école
de musique à Bamako : l’I.N.A. (Institut National des Arts). On y
enseigne la musique moderne et traditionnelle. Nous étions à Niéna pendant la
période de l’hivernage et nous
n’avons pas pu acheter d’instrument à part des Bolis sur le marché. Très
peu de personne possèdent des instrument à Niéna et ceux qui en possèdent en
ont de mauvaise qualité. Ils les utilisent peu et la technique de
l’instrument n’est pas maîtrisée. Nous n’avons pu rencontré à Niéna
qu’un balafoniste. Les musiciens. Ils font partie de la classe des artisans. Ils sont très importants car ils représentent la mémoire de la culture qu’ils racontent dans leurs chansons. Nous avons interrogé les musiciens de
Karangasso. Ils nous ont expliqué qu’ils ne vivent pas de la musique. Ils ne
trouvent que peu d’occasion pour jouer. Ils ont tous un autre travail. Ils
sont cultivateurs, forgerons etc.… Ils sont bien perçus par le reste de la
population. Ils jouent un rôle social dans la ville, pour accueillir des invités
où lors de mariages. Ils jouent gratuitement pour ces occasions. C’est leur
parents qui leur ont appris la
musique. Il n’y a aucune trace écrite, tout se transmet à l’oral. Ils
inventent aussi beaucoup leur musique.
Nous les avons invités deux fois à la concession. La première pour
l’anniversaire de Marie et la deuxième pour la soirée de remerciement. Ce
sont des animateur de soirée hors pair, et nous avons préféré les payer eux
que de louer des batteries et une sono. De plus, les années précédentes, nous
avons lu dans les rapports que seuls les hommes participaient aux soirées
organisées par les jeunes de Teriya et que les enfants étaient très
turbulents et venaient perturber la fête. Or, lors de nos deux soirées, les
enfants ont beaucoup participé sans créer de problèmes et les femmes étaient
bien présentes. Il y avait même plus de femmes que d’hommes. Certains hommes
partaient plus tôt de la soirée, laissant leurs femmes à la fête.
Nous avons rencontré un balafoniste à
Niéna, Aboudou BAMBA. Ils ne sont que deux à jouer du Balafon à Niéna. Cela
fait huit ans qu’il ne joue plus sauf pour une représentation théâtrale
avec une école il y a trois ans. Aboudou nous dit que les jeunes ne s’intéressent
pas à la musique traditionnelle. Même ses enfants n’ont pas voulu
s’initier. Lui-même a appris en autodidacte et aussi avec des gens plus âgé
que lui. Il joue aussi de la N’goni. Avant, il jouait dans les champs pour
encourager les cultivateurs et à la fin de la saison, ils se retrouvaient tous
ensemble pour danser. Les musiciens ne peuvent vivre de leur art. Ils nous dit
aussi que les musiciens sont appréciés de la population mais que certaines
personnes croient que la religion désapprouve la musique. Elles lui ont fait
comprendre qu’il devrait arrêter et faire autre chose de plus sérieux. De
plus, certains musulmans n’aiment pas la musique car la danse mélange les
hommes et les femmes. Aboudou, lui, se sent libre de faire ce qu’il veut. Il est triste que la musique se perde
car avant, les gens jouaient et dansaient ensemble. Ils faisaient la fête et
oubliaient leurs problèmes. Il est prêt à apprendre à quelqu’un qui en
aurait envie mais souvent, certains essayent et arrêtent vite. Il n’aime pas
beaucoup la musique moderne car elle parle trop de sexualité. Lors de notre discussion avec l’Imam
Kasim SANGARE, nous lui avons demandé ce qu’il pensait de la musique
traditionnelle ainsi que de la musique moderne. Il nous a répondu que lui n’était
absolument pas contre la musique et que bien au contraire, il regrette que la
musique traditionnelle se perde et que sa bonne morale se fasse remplacer par la
musique moderne.
La musique
et la danse moderne.
La musique moderne est apparue à la fin du 19ème siècle
avec le début de l’aire coloniale. Aujourd’hui, les jeunes écoutent du
rap, du coupé-décallé ou la musique populaire malienne (Salif Keïta, Rockia
Traoré, etc…). Ils dansent le coupé-décallé ou racommoder, pédaler, tango
tango, fuga fuga. C’est une danse où ils font ce qu’ils veulent. Le coupé-décallé
est le nom d’une chanson Ivoirienne à la mode pour les jeunes à travers
l’Afrique.
Le Mali est l’une des plus grandes figures de la scène musicale
internationale actuelle. Le pays voit sans cesse émerger de jeunes artistes
passionnants qui perpétuerons sûrement les traditions musicales maliennes dans
les années à venir. La musique à l’école.
Les enfants font de la musique à partir du 2ème cycle. Ils
n’écoutent pas de musique. L’école a peu de moyen, pas d’instrument et
pas de vrai professeur de musique. Les professeurs font beaucoup chanter les
enfants. Un enfant nous a dit apprendre à jouer des instruments traditionnels
à l’école, mais en règle général ils nous ont tous dit apprendre le solfège
français. Ceci est dommage car il ne connaissent pas la musique européenne.
Apprendre le solfège sans connaître la musique ne veux rien dire. Il y a dans
les villages quelques bon musiciens, pourquoi ne sont-ils pas embauché dans les
écoles pour enseigner la musique aux enfants ? Nous.
Notre équipe comprenait quatre musiciens. Nous sommes partis à Niéna
en espérant faire de la musique avec des Niénakas. Les premiers soir, nous étions
heureux de voir Adama Diallo, le fils de Fama, et Moussa nous interpréter des
chansons traditionnelles. Puis nous avons demander à ce qu’ils nous apporte
des instruments, mais les seuls qu’ils ont pu nous apporter étaient une mini
cora et une boli de peul qui sert soit comme récipient d’eau, soit comme
percussion. Nous avons passé bon nombre de nos soirées à faire avec eux de la
musique tentant de nous familiariser avec ces instruments et les rythmes.
Nous avons aussi beaucoup joué, au début du séjour, avec les enfants
du quartier, sur les seaux en plastiques de la concession. Les rythmes qu’ils
connaissent sont impressionnant et on se rend vite compte qu’ils ont ça dans
le sang.
Enfin, vers le milieu du séjour, nous avons décidé d’aller jouer
tous les quatre à la radio Teriya afin de faire découvrir notre musique aux
habitants. Nous avons travaillé trois pièces de violon, jouées par Marie et
nous les avons accompagné de percussions avec nos instruments locaux, c’est
à dire casseroles, boite de nescafé contenant des cailloux et boli.
La
radio Teriya.
Après notre passage musical à la radio, le directeur est venu nous
rendre visite à la concession. Il voulais nous entretenir sur leur situation
financière difficile. M. Oudy Diallo, est le nouveau directeur depuis février
2005. Il est aussi maître dans le 2ème cycle.
Le fonctionnement de la radio est médiocre car la portée est faible
(pas plus de 25 km), ce qui réduit la clientèle. La faiblesse de la portée
est due au mauvais fonctionnement de l’émetteur dont les transistors rechangés
à la suite d’un foudroiement ne sont pas convenables. Aussi, le cable
d’antenne est en mauvais état. Enfin, il manque trois dipôles et trois
coupleurs.
Les appareils sont en mauvais état et la radio aurait besoin d’un
mixeur, de deux lecteurs de cassettes, deux micros et trois dictaphones.
Les revenus de la radio sont faibles, à cause de la petite portée de
l’antenne, ce qui réduit la clientèle, préférant faire passer ses messages
par la radio Waténé. Aussi, le groupe électrogène est vieux et consomme
beaucoup d’essences (5L pour 8h) ce qui augmente considérablement les charges
de la radio. D’ailleurs, quand nous sommes allés à la radio nous avons été
choqués par l’état de noirceur des murs et la polution ambiante à proximité
du générateur. Enfin, les réparations improvisée sont souvent très coûteuses.
Dans la période du 1er juillet 2005 au 15 Août 2005, les
recettes sont de 51 300 F CFA, les dépenses 152 850 F CFA, soit une situation débitrice
de 101 550 F CFA.
Le personnel de la radio se compose de sept agents en plus du directeur
qui travaillent bénévolement. Un gardien est embauché pour une somme de 9 000
F CFA par mois.
La radio fonctionne de 9h30 à 14h puis de 18h30 à 23h. La pause entre
14h et 18h30 est principalement due au coût en essence que représenterais une
émission supplémentaire. Un
cybercafé à Niena.
En face de la radio il y maintenant un cybercafé qui a été financé par l’UNESCO. C’est dans une structure moderne que se trouvent les 4 ordinateurs et autres matériels informatiques. C’est à la fin de notre séjour qu’internet fut installé ce qui nous a permis d’envoyer plusieurs mails et d’expliquer aux personnes présentent son fonctionnement.
|
|